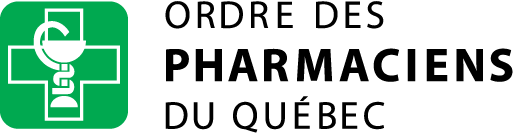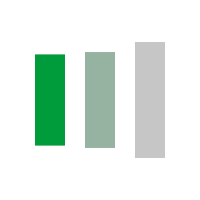En tant que pharmacien(ne), vous pouvez être amené(e) à envisager la substitution entre deux médicaments qui ont la même dénomination commune, mais dont les indications officielles diffèrent. Cette pratique, bien que légalement possible, soulève des considérations cliniques et éthiques.
Ce que vous devez savoir
- Substitution légale et encadrée
Vous pouvez substituer un médicament par un autre ayant le même principe actif, et ce, même si l’indication officielle rattachée au nom commercial est différente (ex. : Wegovy® (Semaglutide) et Ozempic® (Semaglutide), Mounjaro® (Tirzepatide) et Zepbound® (Tirzepatide), Proscar® (Finasteride) et Propecia® (Finasteride), à condition que :- La substitution soit nécessaire et bénéfique pour le patient.
- Le consentement éclairé du patient soit obtenu.
- Une surveillance appropriée de la thérapie soit réalisée.
- Différences d’indications
Lorsque les indications officielles diffèrent selon le nom commercial (ex. : perte de poids vs diabète, hypertrophie bénigne de la prostate vs alopécie), il est essentiel que le patient comprenne ces différences en tenant compte de l’objectif thérapeutique recherché et des implications cliniques de la substitution. - Motivation économique et remboursement
La substitution ne doit pas être motivée uniquement par des raisons financières. Toutefois, elle peut être envisagée si le coût du médicament compromet l’accès ou l’usage approprié de la thérapie. Les règles de remboursement imposées par les assureurs publics et privés compliquent souvent la situation, mais c’est au patient ou à son représentant de juger si le coût constitue un obstacle financier. - Démarche clinique complète
Avant de procéder à une substitution, il est essentiel d’adopter une démarche complète. Celle-ci doit tenir compte des particularités cliniques du patient, du problème de santé traité et des caractéristiques du médicament concerné. Dans certains cas, un ajustement de la posologie peut s’avérer nécessaire, ce qui dépasse le cadre d’une simple substitution et exige une vigilance accrue de votre part. - Documentation
Toute substitution doit être justifiée et documentée de manière claire, complète et centrée sur le patient. Cette documentation doit inclure le contexte clinique, le raisonnement ayant mené à la décision, ainsi que le suivi prévu. - Communication interprofessionnelle
Il est recommandé d’informer le prescripteur surtout en cas de différence d’indication ou si un ajustement de dose est requis pour assurer la sécurité et la qualité des soins. - Consentement éclairé et évaluation des risques
Vous devez évaluer les risques liés à la substitution et obtenir un consentement éclairé du patient. - Enjeux éthiques et sociétaux
Au-delà des considérations pharmaceutiques, certaines préoccupations éthiques méritent votre attention. Celles-ci touchent notamment l’accès équitable aux traitements, la médicalisation de certaines conditions, ainsi que les enjeux liés à la prévention et à la responsabilité sociale.
Pour plus d’informations sur la substitution, consultez le Guide d’exercice – La substitution d’un médicament.